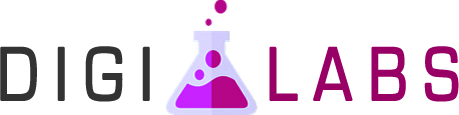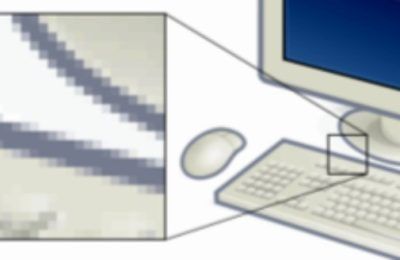- L'histoire du transfert d'informations a toujours cherché à accélérer la communication pour compenser les distances.
- Le projet du câble de l'Atlantique en 1858 a marqué le début de cette révolution technologique, permettant une transmission plus rapide des informations entre le Royaume-Uni et les États-Unis.
- Malgré les progrès de la technologie cloud, certaines entreprises continuent d'utiliser des supports physiques pour leurs transferts d'information, créant un écart entre ceux qui privilégient le physique et ceux qui préfèrent le cloud.
Histoire du transfert d’informations
L’histoire du transfert d’informations est bien loin d’être un long fleuve tranquille. Il a été question, depuis la formation de sociétés civilisées, de toujours accélérer la communication de façon à compenser les distances, toujours plus grandes, entre les cœurs décisionnels des empires et leurs frontières.
Un haut fait de cette histoire semble poser les prémices de la révolution technologique basée sur le clouding telle que nous la connaissons aujourd’hui ; un projet ambitieux, voire insensé, basé sur le télégraphe : le câble de l’Atlantique de 1858.
Il s’agissait de relier l’Amérique du Nord, encore fraîchement indépendante, au vieux Continent par le biais d’un gigantesque câble télégraphique sous-marin. La réussite à terme de ce projet, et après de nombreux échecs, a permis de réduire la transmission d’informations entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis de plusieurs semaines à quelques heures. L’histoire retient moins que le câble est tombé irrémédiablement en panne après quelques semaines d’utilisation, tant la révolution était éclatante. C’était l’amorçage timide d’une nouvelle ère qui en est à son âge d’or à l’heure actuelle.
L’immédiateté de l’information n’était autrefois qu’un fantasme et est pourtant devenue réalité grâce à la technologie du cloud permettant de mettre des informations en ligne accessibles depuis n’importe quel endroit connecté à Internet.
Support physique de l’information
Malgré ces progrès indéniables, une réaction à contre-courant s’observe dans les grandes villes, comme l’indique une étude conduite par la société Mozy spécialisée dans le cloud et l’espace de stockage en ligne et portant sur le volume de données transporté en physique par des employés entre leur entreprise et leur domicile. Les résultats sont particulièrement étonnants et indiquent que les sociétés semblent recourir davantage aux supports physiques pour leurs transferts d’information plutôt qu’à la mise en ligne partagée.
Par exemple, à New York, en une journée, 1,4 exabits de données (14006kilobits, ce qui est plutôt duveteux) sont déplacés en supports physiques. Le chiffre peut paraître vertigineux tel quel, mais il l’est davantage quand on sait que c’est plus que tous les échanges de données ayant lieu sur Internet en l’espace d’une journée.
Il semble donc que l’écart se creuse entre les partisans du physique, favorisés par la miniaturisation et l’augmentation de mémoire exponentielles des disques durs et autres clés USB, et l’école du cloud, statistiquement moins exposée aux vols et aux pertes mais manifestement encore trop récente pour bénéficier de l’approbation de la majorité.
FAQ
Qu'est-ce que le cloud en informatique ?
Le cloud en informatique est un concept de stockage et de partage de données sur des serveurs distants, accessibles via internet. Il permet aux utilisateurs d'accéder à leurs données à tout moment et depuis n'importe quel appareil connecté. Cela offre également une sécurité renforcée grâce à la sauvegarde automatique et régulière des données dans le cloud.
De plus, les services en ligne proposés par le cloud permettent une collaboration et un partage facile entre différents utilisateurs. Le cloud est une solution pratique pour gérer ses données de manière flexible et sécurisée grâce à l'utilisation du réseau internet.
En quoi consiste l'utilisation du cloud ?
L'utilisation du cloud consiste à stocker et accéder à des données, fichiers et applications en ligne, via un réseau internet. Cette technologie permet de stocker une grande quantité d'informations en évitant le recours à des disques durs ou serveurs physiques.
Elle offre également la possibilité de partager facilement des données avec d'autres utilisateurs autorisés et de les sauvegarder automatiquement. Le cloud est ainsi devenu incontournable pour faciliter l'accès aux informations et la collaboration entre individus, entreprises ou organisations.
Quels avantages apporte le cloud aux entreprises ?
L'utilisation du cloud permet aux entreprises de stocker leurs données et applications sur des serveurs externes, ce qui leur fait économiser des coûts en matière d'infrastructure. De plus, cela offre une meilleure flexibilité pour accéder et gérer les données à distance, favorisant ainsi le travail collaboratif. Le cloud permet également une sauvegarde des données plus sécurisée et fiable grâce à la garantie de disponibilité et de redondance offerte par les prestataires spécialisés.
Enfin, l'utilisation du cloud facilite l'échange et le partage de documents entre employés d'une même entreprise ou avec des partenaires externes.